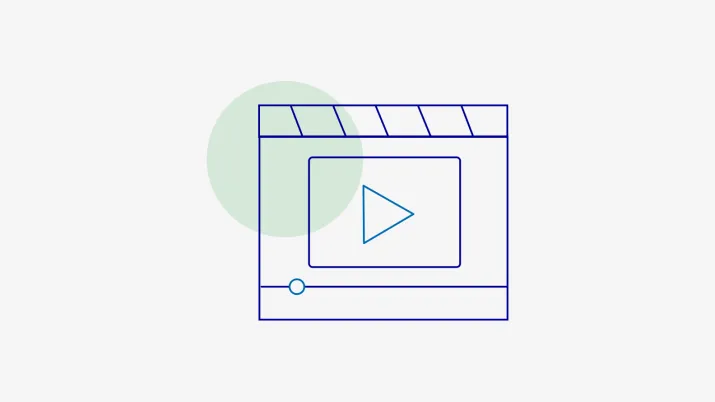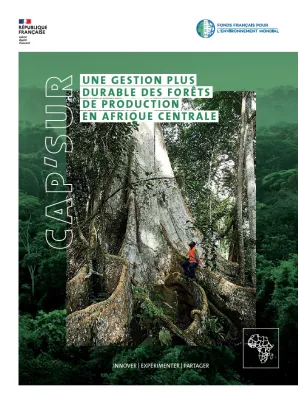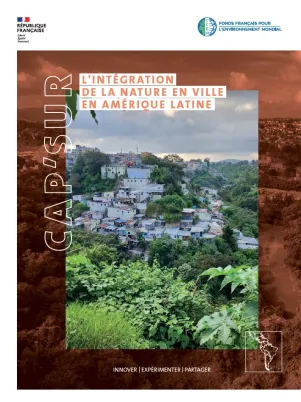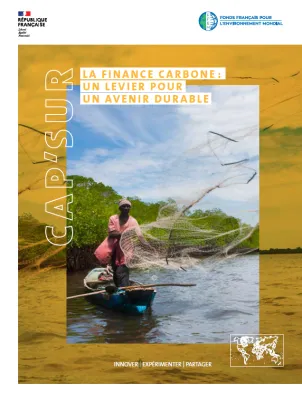Partager la page
Évaluer-capitaliser : un levier pour l’impact et le changement d’échelle
Le FFEM consacre une part de son budget à l’évaluation des projets qu’il soutient, mais aussi à la capitalisation sur les solutions. Explications avec Maëlis Borghese, Responsable des évaluations et capitalisations, suivi du portefeuille en exécution.
Quels sont les principaux défis rencontrés lors des évaluations ?
Maëlis Borghese : Le FFEM soutient l’expérimentation de solutions innovantes dans l’optique de vérifier leur
efficacité, mais aussi d’inspirer d’autres acteurs. Cela demande de tirer le maximum d’enseignements des projets : bonnes pratiques, facteurs de réussite, freins et difficultés… Or, ceux qui les portent n’ont pas toujours le temps, les moyens ou le recul pour réaliser cette analyse. Pour que l’évaluation soit utile, nous mandatons des cabinets d’experts indépendants : nous leur demandons d’aller sur le terrain et de rencontrer les acteurs et les bénéficiaires du projet pour produire leurs rapports. Parfois, quand les résultats ne sont pas probants, les porteurs de projets peuvent aussi être réticents à partager leur expérience. Pourtant, nous insistons sur le « droit à l’essai ».
Nous finançons des expérimentations, nous assumons le risque que certaines ne marchent pas, ou pas tout de
suite. D’ailleurs, on ne parle pas d’échecs : ces projets sont riches d’enseignements, ils sont précieux pour les capitalisations que nous faisons de tous les projets portant sur une problématique commune (voir encadrés). « Les essais non probants ne sont pas des échecs. Ils fournissent des enseignements utiles pour avancer. » MAËLIS BORGHESE, Responsable des évaluations et capitalisations, suivi du portefeuille en exécution
Ces travaux servent-ils aussi à ajuster les orientations du FFEM ?
M.B. : Oui. Par exemple, dans la stratégie 2023-2026, si nous soutenons davantage de projets visant à produire des données scientifiques sur la biodiversité en haute mer, c’est que des initiatives précédentes ont montré que cela pouvait faire avancer les prises de décisions politiques. En démontrant le rôle essentiel des écosystèmes planctoniques, le projet mené par la Fondation Tara Océan entre 2017 et 2021 a contribué à ce que la communauté internationale reconnaisse la nécessité de les préserver et l’inscrive dans le Traité sur la conservation de la biodiversité en haute mer (dit « BBNJ » pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction.), signé en 2023 et en cours de ratification.
Quelle est la part des projets qui passent à l’échelle ?
M.B. : C’est difficile de le mesurer de façon systématique. Il peut parfois s’écouler plus de dix ans entre la fin d’une expérimentation locale et le moment où elle est reprise plus largement dans le pays, ou même ailleurs ! Or, le FFEM a rarement les moyens de suivre l’évolution des projets après son intervention. Le plus souvent, nous avons des nouvelles de façon informelle. Le cas du parc national d’Ifrane, au Maroc, en est un bon exemple. Dans les années 2000, nous avons accompagné sa création. L’institution marocaine en charge des aires protégées y a testé plusieurs approches de gestion partagée avec les communautés locales. Nous n’avions plus de nouvelles jusqu’à ce que, 20 ans plus tard, le responsable du projet de l’époque, devenu chef du département des parcs nationaux et des aires protégées du Maroc recontacte l’AFD et le FFEM pour financer le déploiement de certaines de ces solutions à l’échelle de toutes les forêts du pays. À défaut de pouvoir suivre le devenir de toutes nos actions, nous encourageons les porteurs de projets à mettre en place dès le départ les conditions d’un passage à l’échelle : implication des autorités locales et des acteurs financiers, mesure des impacts, communication et visibilité des résultats sont des éléments clés.
Collection CAP'SUR
CAP'SUR en image
Vidéo : CAP' SUR les forêts d'Afrique Centrale
Publié le 10 janvier 2025
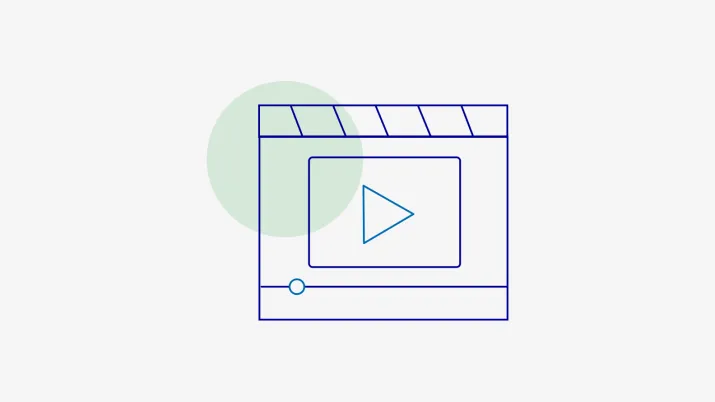
Vidéo : CAP' SUR l'intégration de la Nature en Ville en Amérique Latine
Publié le 23 juin 2023
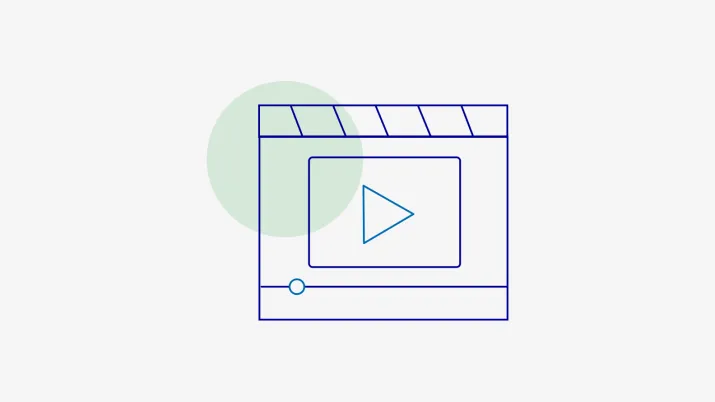
Vidéo : CAP' SUR la Finance Carbone : un levier pour un avenir durable
Publié le 21 janvier 2025