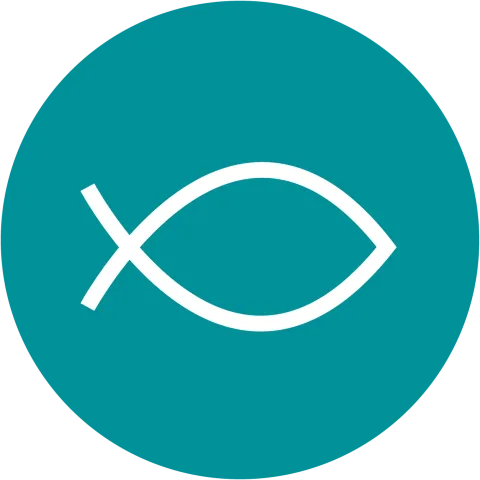Partager la page
Le rapport d'activité 2024-2025 à la loupe
Publié le

Retrouvez sur cette page une sélection des contenus clés du dernier rapport d’activité du FFEM. Vous y trouverez notamment des interviews exclusives de nos partenaires. Explorez ces contenus inédits pour mieux comprendre l’action du FFEM et son engagement en faveur de l’innovation au service de l’environnement et du développement durable.
30 ans d’innovations et toujours précurseur
Changement climatique, perte de biodiversité, pollutions, dégradation des terres et des océans… En 30 ans, les fondamentaux de la crise environnementale et leurs impacts se sont accentués. Face à ces défis, le FFEM adopte une approche de plus en plus intégrée en soutenant des projets à la croisée du développement et de la préservation de l’environnement et répondant simultanément à plusieurs objectifs de développement durable (ODD). La convergence des enjeux y tient une place importante.
Parce que les populations les plus pauvres sont les premières victimes des crises environnementales, le FFEM œuvre pour un partage équitable des bénéfices de ces projets. C’est pourquoi, il mobilise un large réseau de partenaires sur le terrain, publics et privés, issus de la société civile, du monde de la recherche et des territoires.
Une source d’inspiration
La mission du FFEM : identifier des innovations pertinentes pour répondre à ces enjeux, soutenir leur expérimentation sur le terrain et favoriser leur essaimage. Le suivi, l’évaluation et la capitalisation à partir des projets permettent de produire des connaissances utiles aux décideurs et de favoriser le changement d’échelle. Cette démarche s’appuie sur des données scientifiques et vise aussi à renforcer les capacités locales de recherche.
Renforcer la voix de la France
En fournissant des arguments solides en faveur de technologies, de pratiques ou de modes de gouvernance innovants, notre démarche nourrit et renforce les positions de la France dans les négociations environnementales internationales. Qu’il s’agisse de finance carbone, du rôle de l’océan dans la régulation du climat ou d’alternatives au plastique, les recommandations issues du terrain sont partagées au niveau international, comme ce fut le cas lors de la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan à Nice en juin 2025. En plaçant la durabilité, la science et l’équité au cœur de ses priorités, le FFEM agit en tant que catalyseur d’innovations pour la planète et le vivant et contribue à faire évoluer la coopération internationale en plaçant la durabilité, la science et l’équité au cœur de ses priorités. Le FFEM est fier d’avoir célébré ses 30 ans en 2025, ce qui a permis de mettre en lumière son action singulière et d’amorcer la réflexion sur les orientations stratégiques pour la période 2027-2030

Soutenir les engagements environnementaux internationaux
Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) impulse et soutient des solutions innovantes pour accompagner la France et les pays en développement dans la mise en œuvre des conventions environnementales internationales. La période 2024-2025 constitue un momentum pour la diplomatie environnementale mondiale auquel le FFEM a apporté sa contribution.
- Le Traité sur la haute mer (BBNJ pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction) a enfin été adopté. Le FFEM, engagé depuis plus de 12 ans sur la haute mer, a joué un rôle clé en accompagnant des solutions opérationnelles concrètes pour préparer sa mise en œuvre.
- Les négociations internationales se poursuivent autour d’un traité global contre la pollution plastique. Précurseur dans ce domaine, le FFEM soutient des projets pilotes visant la réduction à la source des plastiques par la sensibilisation, l’évolution réglementaire et la recherche d’alternatives.
- Deux ans après l’accord de Kunming-Montréal sur le cadre mondial pour la biodiversité, la COP16 de Cali a mis en avant la participation des communautés locales et rappelé l’objectif ambitieux de protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030. Le FFEM y apporte son expertise solide, notamment en matière de gouvernance partagée des aires protégées, fruit de trois décennies d’expérience de terrain.
- Concernant le climat, alors que la COP29 de Bakou a clarifié l’article 6 sur les marchés carbone, le FFEM a valorisé quinze années de projets liés à la finance carbone, afin de proposer des modèles plus intègres, transparents et équitables, apportant des cobénéfices sociaux et environnementaux. Dans les territoires forestiers, anticipant l’entrée en vigueur du Règlement européen de lutte contre la déforestation importée (RDUE), le FFEM soutient depuis 5 ans des filières agricoles durables de cacao « zéro déforestation », conciliant transition des entreprises, revenu décent pour les producteurs et traçabilité pour les consommateurs.
- Enfin, pionnier des solutions fondées sur la nature, le FFEM soutient de longue date ces approches dans divers écosystèmes – zones côtières, agricoles, forestières ou urbaines – et diffuse largement ces bonnes pratiques, notamment en agroécologie, agroforesterie, restauration de mangroves et nature en ville, répondant ainsi aux recommandations Nexus du dernier rapport de l’IPBES.
Toutes ces avancées et projets, répondant à l’actualité internationale, et réalisés avec un vaste réseau de partenaires internationaux et locaux, sont présentés dans les pages suivantes.

Évaluer-capitaliser : un levier pour l’impact et le changement d’échelle
Le FFEM consacre une part de son budget à l’évaluation des projets qu’il soutient, mais aussi à la capitalisation sur les solutions.
Quels sont les principaux défis rencontrés lors des évaluations ?
Maëlis Borghese : Le FFEM soutient l’expérimentation de solutions innovantes dans l’optique de vérifier leur
efficacité, mais aussi d’inspirer d’autres acteurs. Cela demande de tirer le maximum d’enseignements des projets : bonnes pratiques, facteurs de réussite, freins et difficultés… Or, ceux qui les portent n’ont pas toujours le temps, les moyens ou le recul pour réaliser cette analyse. Pour que l’évaluation soit utile, nous mandatons des cabinets d’experts indépendants : nous leur demandons d’aller sur le terrain et de rencontrer les acteurs et les bénéficiaires du projet pour produire leurs rapports. Parfois, quand les résultats ne sont pas probants, les porteurs de projets peuvent aussi être réticents à partager leur expérience. Pourtant, nous insistons sur le « droit à l’essai ».
Nous finançons des expérimentations, nous assumons le risque que certaines ne marchent pas, ou pas tout de
suite. D’ailleurs, on ne parle pas d’échecs : ces projets sont riches d’enseignements, ils sont précieux pour les capitalisations que nous faisons de tous les projets portant sur une problématique commune (voir encadrés). « Les essais non probants ne sont pas des échecs. Ils fournissent des enseignements utiles pour avancer. » MAËLIS BORGHESE, Responsable des évaluations et capitalisations, suivi du portefeuille en exécution
Ces travaux servent-ils aussi à ajuster les orientations du FFEM ?
M.B. : Oui. Par exemple, dans la stratégie 2023-2026, si nous soutenons davantage de projets visant à produire des données scientifiques sur la biodiversité en haute mer, c’est que des initiatives précédentes ont montré que cela pouvait faire avancer les prises de décisions politiques. En démontrant le rôle essentiel des écosystèmes planctoniques, le projet mené par la Fondation Tara Océan entre 2017 et 2021 a contribué à ce que la communauté internationale reconnaisse la nécessité de les préserver et l’inscrive dans le Traité sur la conservation de la biodiversité en haute mer (dit « BBNJ » pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction.), signé en 2023 et en cours de ratification.
Quelle est la part des projets qui passent à l’échelle ?
M.B. : C’est difficile de le mesurer de façon systématique. Il peut parfois s’écouler plus de dix ans entre la fin d’une expérimentation locale et le moment où elle est reprise plus largement dans le pays, ou même ailleurs ! Or, le FFEM a rarement les moyens de suivre l’évolution des projets après son intervention. Le plus souvent, nous avons des nouvelles de façon informelle. Le cas du parc national d’Ifrane, au Maroc, en est un bon exemple. Dans les années 2000, nous avons accompagné sa création. L’institution marocaine en charge des aires protégées y a testé plusieurs approches de gestion partagée avec les communautés locales. Nous n’avions plus de nouvelles jusqu’à ce que, 20 ans plus tard, le responsable du projet de l’époque, devenu chef du département des parcs nationaux et des aires protégées du Maroc recontacte l’AFD et le FFEM pour financer le déploiement de certaines de ces solutions à l’échelle de toutes les forêts du pays. À défaut de pouvoir suivre le devenir de toutes nos actions, nous encourageons les porteurs de projets à mettre en place dès le départ les conditions d’un passage à l’échelle : implication des autorités locales et des acteurs financiers, mesure des impacts, communication et visibilité des résultats sont des éléments clés.
Le FFEM soutient l’expérimentation de solutions innovantes dans l’optique de vérifier leur efficacité, mais aussi d’inspirer d’autres acteurs. Cela demande de tirer le maximum d’enseignements des projets : bonnes pratiques, facteurs de réussite, freins et difficultés… Or, ceux qui les portent n’ont pas toujours le temps, les moyens ou le recul pour réaliser cette analyse.


Protéger la biodiversité, c’est aussi une question de sécurité alimentaire et d’économie locale
Le récif méso-américain (MAR) s’étend le long des côtes atlantiques du Mexique, du Belize, du Guatemala et du Honduras. Le MAR Fund est un fonds partagé par ces pays, chargé de financer et de coordonner les actions de conservation au sein de cet écosystème remarquable.
La France est très mobilisée à l’international pour que l’objectif 30x30 soit atteint. Un partenariat comme celui du FFEM avec le MAR Fund est-il un levier efficace pour y arriver ?
Oui, c’est un moyen efficace de traduire l’ambition globale en actions locales. Les acteurs régionaux ont une connaissance approfondie des réalités du terrain, du contexte culturel et des besoins des communautés. En collaborant avec eux, les agences internationales savent que les efforts de conservation qu’ils financent seront stratégiquement alignés sur les objectifs mondiaux, tout en étant pertinents et efficaces localement. Prenons l’exemple du Cayman Crown Reef, une zone du Réseau d’Aires Marines (RAM) particulièrement riche en biodiversité. Grâce au partenariat FFEM-MAR Fund, nous avons réussi à le faire reconnaître et protéger par les 2 pays qui le bordent : le Guatemala qui y a établi une zone de fermeture de 10 ans, et le Belize qui a étendu jusqu’à lui sa réserve marine de Sapodilla Cayes. Mais, pour une protection de long terme, nous avons aussi accompagné les pêcheurs dans la diversification de leurs activités, afin qu’ils gagnent en résilience.
En quoi les aires marines protégées sont-elles essentielles pour cette région ?
Elles contribuent à maintenir la connectivité écologique dont dépendent de nombreuses espèces pour survivre et prospérer. Les protéger n’est pas qu’une question de conservation. C’est aussi une question de sécurité alimentaire et d’économie locale (pêche, tourisme, etc.).
Les acteurs régionaux ont une connaissance approfondie des réalités du terrain, du contexte culturel et des besoins des communautés. En collaborant avec eux, les agences internationales savent que les efforts de conservation qu’ils financent seront stratégiquement alignés sur les objectifs mondiaux, tout en étant pertinents et efficaces localement.


Des outils de conservation et un partage plus équitable des bénéfices de la recherche en haute mer
André Abreu revient sur les enjeux de la coopération entre le FFEM et la Fondation Tara Océan, alors que s’ouvrait en juin la 3e Conférence des Nations unies pour l’océan (UNOC), à Nice.
Pourquoi la haute mer – située au-delà des juridictions nationales – est-elle devenue un enjeu si important ?
La haute mer, qui couvre 70 % des océans, demeure quasi inexplorée. Nous connaissons moins de 5 % des espèces qui y vivent. Or, jusqu’ici, aucun cadre juridique ne permettait d’éviter que les autres espèces disparaissent avant qu’on ne les découvre. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ratifiée en 1994, porte davantage sur les frontières maritimes et les droits de passage. Face aux menaces que représentent le réchauffement climatique, les pollutions et la surpêche, il devenait nécessaire de se doter d’un texte complémentaire pour protéger cette biodiversité.
Que va changer le Traité sur la conservation de la biodiversité en haute mer (dit « BBNJ ») ?
Ce texte, adopté en 2023, propose la mise en place d’outils de gestion par zones (aires marines protégées, etc.) avec des modèles inédits de gouvernance, à la fois internationaux et nationaux. Il va aussi améliorer l’accès des pays du Sud aux coopérations scientifiques en renforçant leur capacité à mener des recherches en mer. Tout cela sera financé par un fonds spécial alimenté par les pays signataires et par un mécanisme de partage des bénéfices : pour tous les produits commercialisés grâce à une découverte faite en haute mer (un médicament contenant une molécule de phytoplancton, par exemple), les entreprises devront verser une contribution.
La haute mer, qui couvre 70 % des océans, demeure quasi inexplorée. Nous connaissons moins de 5 % des espèces qui y vivent. Or, jusqu’ici, aucun cadre juridique ne permettait d’éviter que les autres espèces disparaissent avant qu’on ne les découvre.


Réhabiliter les écosystèmes et renforcer les communautés : le parcours de Nébéday
L’association sénégalaise Nébéday est un exemple d’organisation de la société civile qui, après avoir été soutenue par le Programme des petites initiatives (PPI), le FFEM et le Comité français de l’UICN, a réussi à gagner suffisamment en crédibilité pour obtenir une aide directe du FFEM. Jean Goepp, son directeur, revient sur ce parcours.
Quelles actions menez-vous dans la région pour protéger les écosystèmes côtiers et forestiers ?
Nous avons contribué à régénérer les mangroves. Aujourd’hui, celles-ci se portent bien. Les replantations de palétuviers servent surtout dans le cadre d’actions d’éducation des enfants à l’environnement. La zone de transition, entre les mangroves et le biotope continental, nous préoccupe davantage. Comme la mer monte, les sols se salinisent. Nous y introduisons donc des végétaux plus résistants au sel. Mais nous n’agissons pas que dans le delta. Dans le centre du pays, par exemple, nous avons travaillé avec des coopératives de femmes pour créer un charbon de paille, substituable au charbon de bois. Et dans le Nord, nous avons installé plus de 30 000 foyers améliorés, nécessitant 2 à 3 fois moins de bois pour la cuisson des aliments. Cela contribue à réduire la
pression sur les forêts.
Quel rôle ont joué les aides reçues du PPI ?
En quoi ce type de programme est-il important pour les initiatives locales dans les pays du Sud ?
Jusqu’à récemment, même si nous avions un plan stratégique et des solutions, nous étions trop petits pour que les bailleurs classiques aient confiance en notre capacité à gérer un budget conséquent. Le PPI, créé par le FFEM et le Comité français de l’UICN France, a donc été bienvenu. L’équipe était à l’écoute et a proposé des formations et des visites d’échange avec d’autres porteurs de projets. Surtout, le fait d’avoir eu plusieurs subventions du PPI a été un gage de sérieux auprès de l’Union européenne, puis du FFEM, pour obtenir de plus gros montants.
La zone de transition, entre les mangroves et le biotope continental, nous préoccupe davantage.


La Selva Maya, un modèle de gestion communautaire
En 1996, le Guatemala confiait à des autochtones la gestion de concessions dans ses aires forestières protégées. Marie Ange Ngo Bieng, écologue au Cirad, nous explique pourquoi ce cas est exemplaire.
La gestion communautaire des écosystèmes n’est pas toujours gage de réussite. Pourquoi le modèle guatémaltèque fonctionne-t-il ?
Au milieu des années 1990, après la guerre civile, le gouvernement du Guatemala a choisi de faire confiance aux communautés locales de la réserve de biosphère Maya. Plutôt que de les déplacer, il leur a confié la gestion de concessions forestières dans la zone d’usages multiples de cette réserve, mais en définissant précisément les activités autorisées et encadrées par des règles strictes : exploitation durable du bois et agriculture limitée à l’autoconsommation. Résultat : les taux de déforestation sont quasi nuls au sein de ces concessions. À l’inverse, les zones voisines sont fortement dégradées par l’élevage intensif, les feux illégaux et le narcotrafic.
Plutôt que de les déplacer, il leur a confié la gestion de concessions forestières dans la zone d’usages multiples de cette réserve, mais en définissant précisément les activités autorisées et encadrées par des règles strictes


Un rôle d’innovation nécessaire pour nourrir les COP
Le FFEM constitue pour l’AFD un véritable instrument d’innovation. Il observe avec attention les expérimentations menées et les résultats obtenus, comme le souligne Thomas Mélonio, directeur exécutif de l’Innovation, de la Stratégie et de la Recherche.
Le FFEM joue un rôle d’exploration en amont des négociations climatiques internationales, en faisant la démonstration de la faisabilité, de l’efficacité et de la viabilité de solutions innovantes. Un certain nombre de technologies et de méthodes aujourd’hui utilisées pour remplir les objectifs climatiques ont été auparavant validées par des projets pilotes financés par le FFEM. Les décideurs ont en effet besoin de preuves de résultats avant de miser sur un nouvel outil.
Prenons l’exemple des énergies renouvelables : les expérimentations menées dans les années 2000 ont montré qu’elles pouvaient être rentables, en plus d’être écologiques, donc qu’elles pouvaient séduire les investisseurs. Il devenait possible de fixer des objectifs qui s’appuient sur leur expansion. Plus récemment, le FFEM a financé des projets qui démontrent que, dans certaines conditions, les crédits carbone fonctionnent. De la même manière, il s’intéresse à ce qui fait le succès d’une aire protégée sur le long terme.
Par ailleurs, le FFEM a identifié et investi plusieurs niches d’innovation qui prendront assurément de l’ampleur ces prochaines années. C’est le cas par exemple des déchets du secteur du numérique. Bien qu’ils soient toujours plus nombreux, ils sont encore dans l’angle mort de la plupart des acteurs du développement international. Les projets financés par le FFEM sur ce thème se multiplient, à l’image du projet WEEECAM, lancé en 2017 a au Cameroun pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Le FFEM a en outre une approche innovante de la prévention et du traitement des déchets plastiques. Ce sujet est souvent traité comme une problématique locale, alors qu’il s’agit d’un défi global, contribuant à la pollution des océans. Il faut donc développer de nouvelles solutions, car celles d’aujourd’hui ne sont pas à la hauteur.
Le FFEM joue un rôle d’exploration en amont des négociations climatiques internationales, en faisant la démonstration de la faisabilité, de l’efficacité et de la viabilité de solutions innovantes. Un certain nombre de technologies et de méthodes aujourd’hui utilisées pour remplir les objectifs climatiques ont été auparavant validées par des projets pilotes financés par le FFEM.


À l’écoute des réalités du terrain, le FFEM dépasse la logique nord-sud
Les négociations en vue d’un traité international contre la pollution plastique reprennent cet été à Genève. Marine
Collignon, sous-directrice adjointe de l’environnement et du climat au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, revient sur le rôle actif de la France dans ces échanges.
Quelle est la position défendue par la France dans le cadre de ce futur traité ?
Comme nous l’avons réaffirmé le 10 juin 2025 en signant l’appel de Nice pour un traité ambitieux et contraignant, notre priorité est d’arriver à un texte qui ne se préoccupe pas que de gérer ce type de déchets, mais s’attaque à la source du problème, c’est-à-dire à la réduction du plastique. Cela passe par une baisse de la production, l’interdiction des plastiques à usage unique, ou encore l’écoconception. Agir uniquement sur la collecte et le traitement ne suffit pas, nous le constatons en France et en Europe. En outre, cela ferait porter la plus grande part de la responsabilité sur les pays en développement, premières victimes de l’amoncellement de plastiques dans leurs décharges et cours d’eau.
Au-delà du plastique, comment la France s’engage-t-elle dans les différentes conventions internationales existantes contre les pollutions ?
Nous défendons une approche intégrée. En effet, si l’interdiction d’un polluant conduit à le substituer par un autre, cela ne fait que déplacer le problème. C’est aussi l’avis des 195 pays qui se sont réunis à Genève en mai 2025, pour la triple Conférence des Parties aux Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Plusieurs avancées y ont été obtenues : élargissement de la liste des polluants organiques persistants (POP) interdits, renforcement de la réglementation sur l’exportation des déchets plastiques, lignes directrices pour plus de transparence dans le commerce de substances chimiques dangereuses, etc.
Comme nous l’avons réaffirmé le 10 juin 2025 en signant l’appel de Nice pour un traité ambitieux et contraignant, notre priorité est d’arriver à un texte qui ne se préoccupe pas que de gérer ce type de déchets, mais s’attaque à la source du problème, c’est-à-dire à la réduction du plastique.

Retrouvez l'intégralité du rapport d'activité du FFEM 2024-2025
Les chiffres clés du Rapport d'activité 2024-2025
-
263 projets financés pour un montant de 332,1 M€ en faveur de la biodiversité (de 1994 à 2024, en comptant les projets avec cobénéfices)
-
57 projets financés pour un montant de 66,6 M€ sur les eaux internationales (de 1994 à 2024, en comptant les projets avec cobénéfices)
-
127 projets financés pour un montant de 165,8 M€ contre la déforestation (de 1994 à 2024, en comptant les projets avec cobénéfices)
-
276 projets financés pour un montant de 343,9 M€ en faveur du climat (de 1994 à 2024, en comptant les projets avec cobénéfices)
Nos dernières actualités
Innover ensemble : la force de la coopération du FFEM, bâtisseur de ponts entre le Sud et le Nord
Publié le 12 septembre 2025